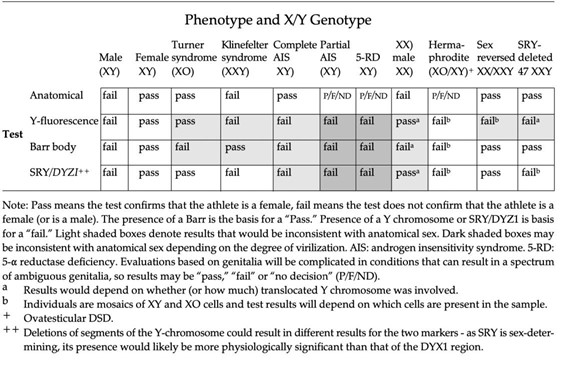Jugements récents axés sur la sensibilité et les impératifs biologiques de l’animal
Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante
Dans deux récents jugements de séparation conjugale, les tribunaux québécois ont exprimé leur ouverture à attribuer la garde de l’animal en fonction de sa sensibilité et de ses impératifs biologiques. L’animal pourrait alors être attribué à un conjoint ou une conjointe selon sa capacité à respecter la sensibilité de l’animal et à satisfaire ses impératifs biologiques. Analyser ainsi un dossier pourrait mener à une garde exclusive ou encore une garde partagée, selon les faits de l’espèce. Prétendre détenir un titre de propriété sur l’animal ne serait pas, selon cette approche, déterminant pour en décider l’attribution.
Cette nouvelle approche pourrait avoir une incidence importante sur l’issue des dossiers que les juges analyseront dans les années à venir. Cette approche n’émerge pas d’un vide. Elle se base sur une réflexion doctrinale costaude développée par le professeur Alain Roy dans « La garde de l’animal de compagnie lors de la rupture conjugale »[1] et la professeure Alexandra Popovici dans « Chercher la petite bête : les animaux dans le Code civil du Québec »[2], que nous avons approfondie dans « L’animal de la famille : un sujet sensible »[3]. Cette approche développée avec rigueur par la doctrine commence ainsi à recevoir une reconnaissance en jurisprudence.
Pour en savoir plus sur les fondements juridiques de l’approche axée sur la sensibilité animale, consultez « L’animal de la famille : un sujet sensible ».
Boucher c. Cadorette
Dans Boucher c. Cadorette (2025 QCCQ 1102), un couple qui se sépare s’adresse à la Cour du Québec afin de déterminer qui est propriétaire de la chienne Willow adoptée deux ans plus tôt. Chacune des parties, qui étaient en union de fait, affirme être propriétaire de l’animal et rejette la possibilité d’une copropriété indivise. De plus, aucune des parties ne revendique la garde exclusive ou partagée de l’animal en cas d’attribution de la propriété à l’autre partie. Après une analyse de la preuve, le juge Dominique Roux conclut que monsieur MAB est propriétaire de Willow.
Cela étant, le juge Roux évoque la possibilité d’aménager la garde de l’animal entre les parties en fonction de la sensibilité et des impératifs biologiques de Willow. Le juge Roux note en effet que « la contribution de [madame AC] au bien-être de Willow dépasse largement celle de son ex-conjoint » et qu’« [e]lle semble la mieux outillée pour poursuivre de façon optimale le développement et l’épanouissement de l’animal » (paragr. 125). Il explique alors que d’attribuer la propriété de Willow à monsieur MAB ne signifie pas nécessairement que Willow devrait être coupée de toute relation avec AC. Plutôt, l’article 898.1 du Code civil du Québec (C.c.Q.) permettrait à madame AC de maintenir des contacts importants avec l’animal :
[110] En attribuant la propriété exclusive de Willow à monsieur Boucher, le Tribunal a épuisé sa juridiction. Comme les parties ne demandent pas la garde de l’animal sans égard au titre de propriété, aucune ordonnance ne peut être émise en ce sens.
[111] Le juge soussigné se permet toutefois quelques remarques (obiter dictum) qui n’exigent pas la réouverture des débats, dans la mesure où le litige pouvait être tranché sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’article 898.1 C.c.Q.
[112] Introduit en 2015, cette disposition place les animaux dans une « nouvelle catégorie innomée ». Il n’est donc plus question de les traiter comme des biens laissés au bon vouloir ou au diktat de leur propriétaire, ni comme « des choses au sens du droit, mais plutôt [comme] des êtres […] déréifiés par un acte législatif ».
[113] L’assujettissement de l’animal au cadre juridique régissant les biens implique qu’une personne physique ou morale puisse l’acquérir, le posséder et le céder. Néanmoins, l’article 898.1 C.c.Q., qui « a […] valeur de norme comportementale », établit « la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres ».
[114] À ce sujet, le professeur Roy écrit :
Bien qu’il puisse toujours en revendiquer la possession, le propriétaire de l’animal doit donc désormais exercer ses prérogatives à la lumière de tous ses impératifs biologiques. Non seulement il doit s’abstenir de gestes qui vont à l’encontre de tels impératifs biologiques, mais il doit aussi agir de manière à favoriser le développement et l’épanouissement de son animal. Son obligation est de nature active, et non simplement passive.
[Nos soulignements]
[115] Les « impératifs biologiques » de l’animal, auxquels réfère le premier alinéa de l’article 898.1 C.c.Q., sont des « besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental ». Comprise dans ces besoins, la socialisation se conjugue à la sensibilité de l’animal.
[116] L’approche préconisée dans l’affaire Marquis c. Harvey est une belle illustration de « l’effet utile » que doit avoir le premier alinéa de l’article 898.1 C.c.Q., à travers l’imposition d’obligations spécifiques aux propriétaires d’animaux. Comme en l’espèce, les partenaires faisaient vie commune sans être assujettis à quelconque régime (matrimonial ou union civile) et aucune entente ne déterminait les modalités de partage en cas de rupture. Durant leur union, ils ont acquis deux chiens et en étaient tous deux copropriétaires (se partageant le prix d’achat et les dépenses nécessaires aux soins et à l’entretien des animaux).
[117] Après la séparation, la Cour supérieure doit déterminer qui gardera les chiens. À ce moment, le conjoint n’a pas vu ses animaux depuis deux ans. Au lieu de limiter son analyse au seul titre de propriété, la juge Sophie Picard, J.C.S., tient compte des besoins des deux animaux pour accorder la garde exclusive à la conjointe, évitant ainsi de les séparer. Elle conclut comme suit :
[87] Par conséquent, vu l’affection profonde qu’éprouve Mme Harvey à l’égard des deux chiens et la dynamique de jeu existant entre ceux-ci, il est préférable de préserver la situation actuelle, malgré le vide que ceci représentera pour M. Marquis. Il est à espérer qu’il pourra, dans un avenir rapproché, développer avec un nouveau chien, le même type de « connexion » que celle qui existait avec Pico.
[118] Les auteurs Lessard et Plante regrettent que ce jugement soit isolé dans l’écosystème judiciaire. En effet, « l’approche fondée sur la propriété » domine depuis 2015, malgré l’introduction de l’article 898.1 C.c.Q.. Or, cette voie devrait être délaissée « au profit d’une nouvelle approche » qui aménage la garde de l’animal « de manière à respecter sa sensibilité et ses impératifs biologiques ».
[119] À titre d’exemple, poursuivent les auteurs, la relation entre l’animal et les membres d’une famille, qu’il s’agisse de l’ex-conjointe ou conjoint ou des enfants, « pourrait être maintenue si cela sert son bien-être », nonobstant le titre de propriété.
[120] Le professeur Roy abonde dans le même sens :
Si les impératifs biologiques de l’animal ne se limitent pas à ses besoins physiques et physiologiques, et qu’il faut les évaluer en fonction de l’espèce animale à laquelle il appartient, on pourra difficilement exclure de leur portée les liens affectifs que l’animal de compagnie, et plus particulièrement le chien, aura pu développer avec les personnes qui en prennent soin. Ces liens constitueront autant de stimulus susceptibles de favoriser son bien-être et son épanouissement. On ne saurait donc les rompre sans conséquence significative pour l’être sensible que constitue désormais l’animal.
[…]
À notre avis, les impératifs biologiques de l’animal pourraient justifier le maintien des liens significatifs que ce dernier aura pu développer avec le conjoint qui ne peut en réclamer la propriété, voire avec tout autre membre de la famille. Autrement dit, le conjoint propriétaire de l’animal de compagnie aura beau brandir son titre d’acquisition, il pourrait, selon nous, se voir imposer une « garde partagée » de l’animal ou, à tout le moins, des droits d’accès en faveur du conjoint non-propriétaire dans la mesure où les impératifs biologiques de l’animal le justifient. Dans un tel contexte, la notion d’impératifs biologiques de l’animal pourrait donc constituer l’équivalent conceptuel du principe de l’intérêt de l’enfant.
[Nos soulignements]
[121] Le Tribunal est d’accord avec ces propos.
[Soulignements du tribunal ; gras ajoutés ; références omises]
Selon le tribunal, le fait de priver madame AC de tout droit vis-à-vis Willow en raison de la rupture conjugale et de l’attribution de la propriété exclusive à monsieur MAB « équivaudrait à priver d’effet le premier alinéa de l’article 898.1. C.c.Q. » (paragr. 126). Si le tribunal n’avait pas, en l’espèce, à statuer sur la garde de l’animal, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence évoque désormais, depuis l’adoption de l’article 898.1 C.c.Q., que la sensibilité et les impératifs biologiques de l’animal doivent être pris en compte dans les procédures familiales qui le concernent, et ce, indépendamment du titre de propriété.
Droit de la famille — 251080
Dans Droit de la famille — 251080 (2025 QCCS 2859), un couple marié s’adresse à la Cour supérieure du Québec afin de régler son divorce. Dans ce cadre, madame AL demande à être déclarée propriétaire du chien Love, acquis par monsieur GJ avant le mariage, parce qu’elle a assumé principalement les soins de l’animal. Ainsi, encore une fois, aucune des parties ne revendique la garde exclusive ou partagée de l’animal en cas d’attribution de la propriété à l’autre partie. Les deux parties considèrent que le chien Love est la propriété de monsieur GJ ; madame demande le transfert de cette propriété en sa faveur. Après analyse, le juge Mathieu Piché-Messier conclut qu’un tel transfert de propriété n’est pas possible puisque, « à ce jour, aucune autorité jurisprudentielle ou doctrinale ne lui permettrait d’utiliser l’article 898.1 C.c.Q. pour ordonner le transfert du titre de propriété de Monsieur sur Love à Madame » (paragr. 85).
Cela étant, le juge Piché-Messier explique qu’il aurait été ouvert à ce que madame AL demande la garde du chien Love, même en l’absence de titre de propriété, sur la base de la sensibilité et des impératifs biologiques de l’animal. Par souci de clarté, précisons que la preuve ne suggère pas que madame AL s’occuperait mieux du chien, de sorte qu’elle n’aurait pas nécessairement obtenu la garde de l’animal dans les faits, mais le juge explique que, en droit, une telle demande aurait pu lui être adressée. En effet, le juge Piché-Messier considère approprié d’adopter une approche globale fondée à la fois sur le titre de propriété et sur la sensibilité et les impératifs biologiques d’un animal pour octroyer la garde ou les droits d’usage d’un animal à une partie, bien que cela ne lui soit pas demandé en l’espèce :
[69] Traditionnellement, la propriété d’un animal à la suite d’une rupture est déterminée en fonction de la partie présentant la preuve du titre de propriété la plus convaincante, notamment en établissant qui en avait assumé l’achat.
[70] En 2015, dans le contexte de l’adoption de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal [(L.b.s.a.)], le législateur a ajouté l’article 898.1 du Code civil du Québec qui prévoit que :
898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques.
Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables.
[71] L’approche jurisprudentielle fondée sur le titre de propriété est encore majoritaire et s’appuie sur le contenu du second alinéa de l’article 898.1 C.c.Q.
[72] Toutefois, dans la mesure où le législateur ne parle pas pour ne rien dire, le premier alinéa de 898.1 C.c.Q. ouvre la porte à de nouvelles interprétations sur la base d’une analyse globale de la situation de l’animal. Ainsi, dans le cadre d’une séparation, la « sensibilité » et les « impératifs biologiques » de l’animal, permettraient au Tribunal de prendre en compte un contexte plus large que la simple existence d’un titre de propriété.
[73] En plus du titre de propriété, cette analyse globale permettrait de prendre en considération, entre autres, les liens d’attachement entre l’animal et certains membres de la famille, incluant les autres animaux, le milieu de vie d’un époux, sa disponibilité et sa motivation à s’en occuper et la présence de mauvais traitement ou de négligence, le tout en fonction des impératifs biologiques tels que définis dans la L.b.s.a.
[74] Dans la décision Marquis c. Harvey, la Cour prend en compte plusieurs facteurs étrangers au statut de propriété, tels que la dynamique de jeu entre les deux chiens, la faculté des parties à s’en occuper ainsi que leur degré d’attachement.
[75] À la lumière de l’article 898.1 C.c.Q. et des éléments précédents, le Tribunal estime légitime d’adopter, afin de déterminer une propriété contestée d’un animal, une approche globale tenant compte du titre de propriété (qui demeure déterminant et peut, dans certains cas, faire présumer la propriété), des impératifs biologiques et sensibles d’un animal, notamment en contexte de séparation.
[76] Ainsi, l’approche traditionnelle fondée sur le titre de propriété demeure applicable, mais elle peut être modulée selon la sensibilité et les besoins biologiques de l’animal. Le Tribunal pourrait notamment s’inspirer des critères énoncés dans une décision récente de première instance au Nouveau-Brunswick résumant bien l’état du droit en common law sur la question de la détermination de la propriété d’un animal en matière familiale : […]
[77] Selon une telle approche modulée, il pourrait être légitime, dans certaines circonstances, de déroger au titre de propriété, afin d’accorder la garde, un droit d’usage ou potentiellement, de déterminer un droit de copropriété, sur un animal lorsque les impératifs biologiques et sensibles de l’animal le justifient.
[78] Ainsi, en matière de droit d’usage d’un animal, le juge Guillot-Hurtubise j.c.s., dans un jugement récent en matière d’ordonnance de sauvegarde familiale, énonce notamment ce qui suit :
[63] The author Alain Roy argues that the novel characterization of animals set by art. 898.1 C. C. Q. lays the foundation for a new paradigm that Courts must take into consideration, notably in the context of divorce or separation proceedings. […]
[65] The Court reiterates that, pursuant to article 898.1 C.C.Q., the biological needs of animals must be taken into consideration when making decisions that concerns them. The Court is of the opinion that it can rely on article 898.1 C.C.Q. to grant a right of use of an animal during the course of a proceeding, whether or not it involves a dispute on its ownership, if it is justified by their sentient nature and biological needs.
[66] Granting a right of use of animals, until a judgment on the merits is rendered, might imply that they stay in their habitual residence or follow their primary caregiver. ln family matters such as this one, the best interest of the chiId may additionally serve as a basis for such a right if the bond forged with the animals justify that they remain in the same primary environment as the child.
[Références omises]
[79] L’auteur Alain Roy et les auteurs Lessard et Plante proposent une perspective d’analyse globale similaire en matière de garde ou de droit d’usage de l’animal. Ces derniers écrivent :
L’approche fondée sur la propriété se concentre exclusivement sur le second alinéa, qui expose la continuité de l’application du droit des biens aux animaux. Or, rien ne justifie que seul le second alinéa ait une incidence juridique : il est tout aussi impératif d’accorder une force normative au premier alinéa. La reconnaissance par le Code civil du Québec de la sensibilité et des impératifs biologiques des animaux commande un respect de ceux-ci qui aille au-delà du symbolique. […]
Nous proposons ainsi que la garde de l’animal soit aménagée de manière à respecter sa sensibilité et à satisfaire ses impératifs biologiques. Ceci pourrait impliquer d’octroyer la garde de l’animal à la partie qui respectera le mieux sa sensibilité et qui satisfera le mieux à ses impératifs biologiques. Cela pourrait également impliquer qu’une garde partagée soit prévue entre les parties, voire de permettre à l’animal de suivre l’enfant de la famille lorsque lui-même est en garde partagée. Cette norme proposée mettant en avant la sensibilité et les impératifs biologiques de l’animal, en plus de s’appliquer aux juges qui doivent mettre en œuvre l’article 898.1 C.c.Q., s’appliquerait également aux parties, qui sont soumises à l’article 898.1 C.c.Q.
Les tribunaux semblent résister à cette proposition en raison du second alinéa de l’article 898.1 C.c.Q., selon lequel le droit relatif aux biens s’applique toujours aux animaux. Or, l’application du droit des biens aux animaux ne signifie pas nécessairement que la garde de l’animal doive être confiée à la personne qui en détient le titre de propriété. En effet, le droit des biens reconnaît déjà que la propriété d’un élément n’emporte pas toujours sa maîtrise effective. Par exemple, en droit des familles, l’article 410 C.c.Q. permet au tribunal d’attribuer l’usage de la résidence familiale et des meubles qui servent au ménage à un des partenaires qui n’en est pas propriétaire. Pourtant, personne ne prétend que le droit des biens ne s’applique pas à la résidence familiale et à ses meubles. Ainsi, le droit des biens peut faire fi du titre de propriété lorsqu’il aménage la maîtrise matérielle d’un bien. D’ailleurs, le premier alinéa de l’article 898.1 C.c.Q. est lui-même une disposition spécifique relevant du droit des biens, puisqu’il constitue la disposition générale du livre « Des Biens / Property », du Code civil du Québec. Nous proposons donc de mettre en œuvre une approche à la propriété existant déjà en droit des familles, et ce, depuis plusieurs décennies. […]
En somme, notre approche préconise que la garde soit octroyée à la personne qui ne causera pas de souffrance indue à l’animal et qui satisfera ses impératifs biologiques.
[Le Tribunal souligne et références omises]
[80] Toutefois, le Tribunal rappelle que dans le présent dossier, Madame ne demande pas de déterminer le droit de propriété, la garde ou le droit d’usage sur Love mais bien que le Tribunal lui transfère le droit de propriété sur Love.
[81] Or, bien que le Tribunal puisse juger approprié d’adopter une approche globale, fondée à la fois sur le titre de propriété et sur la sensibilité et les impératifs biologiques d’un animal pour octroyer, dans certains cas et lorsque les circonstances le justifient, la garde ou les droits d’usage d’un animal à une partie, ce n’est pas ce qui lui est demandé en l’espèce.
[Soulignements du tribunal ; gras ajoutés ; références omises]
Là encore, bien que le tribunal n’ait pas eu à se prononcer sur la garde de Love, il souligne explicitement la pertinence d’une approche adaptée à la sensibilité et aux impératifs propres à l’animal, s’inscrivant dans une jurisprudence qui prend véritablement en considération l’article 898.1 C.c.Q. ainsi que les conséquences normatives qui en découlent.
Conclusion
Ces décisions récentes marquent un tournant significatif dans la manière dont les tribunaux québécois envisagent la place de l’animal dans les litiges familiaux. En reconnaissant que l’animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques, les juges ouvrent la voie à une analyse qui dépasse le titre de propriété. Si le titre peut demeurer pertinent, il n’est plus suffisant à lui seul pour trancher l’avenir d’un animal lors d’une séparation. L’évolution jurisprudentielle, inspirée par une doctrine déjà bien établie, illustre la volonté croissante de rapprocher le droit des réalités vécues par les familles et par les animaux qui en font partie. Cette jurisprudence émergente propose une transition vers une approche plus nuancée et respectueuse du bien-être animal, qui pourrait, à terme, transformer durablement la place de l’animal dans le droit de la famille au Québec.
Dans le contexte d’une ordonnance de sauvegarde, consultez « La garde de l’animal de la famille lors d’une séparation : commentaires sur Fortier c. Geoffroy-Béliveau » et Droit de la famille — 25605, (2025 QCCS 2978).
[1] Alain Roy, « La garde de l’animal de compagnie lors de la rupture conjugale », (2022) 51:1 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 249.
[2] Alexandra Popovici, « Chercher la petite bête : les animaux dans le Code civil du Québec », dans Nathalie Vézina, Pascal Fréchette et Louise Bernier (dir.), Mélanges Robert P. Kouri : L’humain au cœur du droit, Montréal, Yvon Blais, 2021.
[3] Michaël Lessard et Marie-Andrée Plante, « L’animal de la famille : un sujet sensible », (2022) 52:3 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 729.